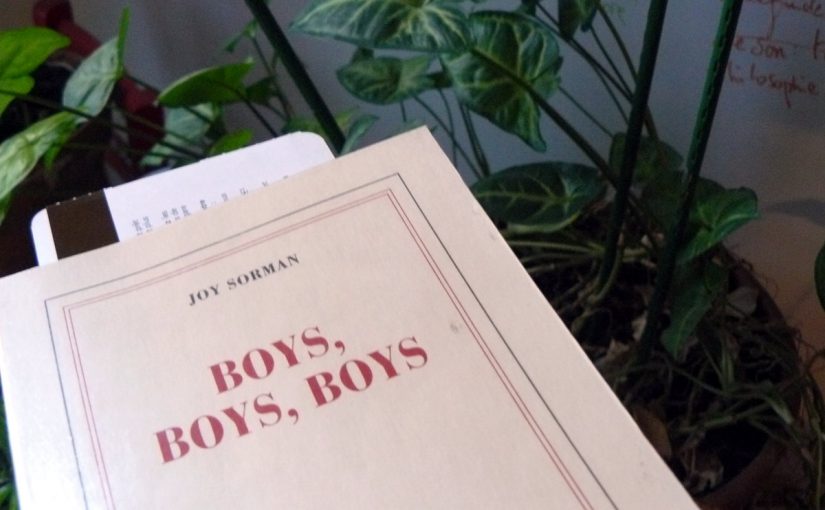Il y a quelques années, je participais à l’émission la Campusienne. Cette année, après quelques mois de silence, l’émission a repris l’antenne. On y parle de plein de choses, c’est un peu un magazine radiophonique. Les animatrices l’annoncent : c’est l’émission qui féministe les oreilles ! Ce que j’aimais particulièrement, quand je participais à cette émission, c’est que je m’autorisais à dire à haute voix mon « je » féminin.
Pour moi, le fait de devoir assumer constamment son sexe social, son genre, cette virilité imposée par le fait d’être un garçon, est pesant. Car si parfois je me sens en accord avec ce sexe que la biologie m’a imposé, souvent ça n’est pas le cas, et alors le fait que l’on m’y renvoie est vécu comme une agression. Car parfois, je sais que je suis une fille, au sens où la société l’entend.
Il y a toujours ces moments où le groupe se divise en deux, d’un côté pour mener des activités « de garçons », de l’autre des activités « de filles ». Et si tu ne choisis pas la bonne équipe, on a tôt fait de te le faire remarquer. Soit pour te dire que tu n’es pas à ta place, soit pour te dire que « vraiment c’est bien que tu t’intéresses à ça, c’est rare pour un garçon ».
J’ai la chance d’avoir quelques cercles d’ami·e·s où l’on peut s’exprimer, vivre, passer une soirée sans qu’une seule fois on nous renvoie à cette étiquette imposée. Parfois je me dis qu’une solution serait de vivre dans un monde où son sexe serait aussi peu catégorisant que la couleur de ses yeux.
Mais il est certain que cette position est utopique : les femmes qui réfléchissent, discutent, se battent au quotidien pour que leur existence ne soit pas ignorée, celles qui portent les actions militantes féministes, celles-ci défendent l’idée d’ateliers et de rencontres en non mixité. Pour que la parole se libère, pour une fois une seule ne pas vivre la pression sociale de la présence masculine.
Les codes de la séduction contemporaine sont aussi particulièrement teintés de ces rôles genrés, combien de fois j’entends des militant·e·s antisexistes ou féministes raconter leurs crushs, très souvent guidés par des réflexes et des mécanismes où l’homme doit assurer son rôle d’homme, la femme son rôle de femme. Il faudrait donc que chacun·e soit autorisé à naviguer entre ces différents rôles, sans s’y retrouver enfermé·e.
La semaine dernière, j’ai lu Boys, boys, boys, un roman autobiographique de Joy Sorman. L’autrice écrit « Je ne veux ni l’égalité, ni la guerre des sexes, je veux un seul sexe…» Pour elle, c’est un sexe virile que tout le monde doit adopter. Alors elle y raconte son envie de changer de sexe, de devenir un garçon. Pas biologiquement, hein, mais socialement. On suit donc cette jeune femme qui en a marre d’être cantonnée à des soirées entre copines, où les discussions sont celles de l’intérieur, où jamais l’on ne parle de politique, ou de trucs super techniques. Alors elle décide de fréquenter une bande de garçons, et de vivre comme un garçon. À fumer, boire, faire n’importe quoi jusqu’à pas d’heure. Elle y parle alors du regard de la société sur qui elle est, de ses rencontres amoureuses, de ses soirées, des discussions à bâtons rompus. Puis de la question du couple, de comment peut exister une relation amoureuse durable dans un schéma où l’on refuse le sexe social. De la manière de ne pas être un couple en public, pour préserver la sociabilisation de chacun·e. Puis des déboires de la vie, de l’errance amoureuse.
D’un côté je me retrouve dans l’envie de quitter mon sexe social, mais en parallèle, je ne me retrouve pas dans ce qu’elle projette sur le rôle social des garçons et dans celui des filles. Car ce que l’on retient de ce bouquin, c’est que la vie des garçons, c’est cool, c’est le mouvement, c’est l’action, c’est virile et puissant, quant la vie des filles est chiante, tournée vers l’intérieur, gagne-petit, futile. C’est bien sûr un roman, et comme dit l’autrice : « Boys est un récit un peu autofictionnel et qui n’est pas dénué de mauvaise foi » (Libération, 8 mars 2010). Mais on n’entend pas combien la violence virile peut faire des victimes. Le positionnement de l’autrice sur le féminisme ainsi est un peu compliqué, en retrait d’un mouvement militant qui défend celles qui sont les victimes de ce mécanisme de virilité dominante.
Ce que je regrette aussi, c’est qu’on n’entende pas non plus la violence que peut entraîner ce mécanisme de virilité dominante sur certains garçons. Ce ne sont pas des femmes, ils n’ont pas le mouvement féministe pour les soutenir. Ce ne sont pas forcément des homosexuels, ils n’ont pas forcément envie d’aller se réfugier dans le mouvement gay. Ils ont cette possibilité de se glisser dans le groupe des garçons dominants, d’ailleurs parfois ils se retrouvent dans cette position où ils produisent chez d’autres de la souffrance. Alors ils ne peuvent pas rejoindre de mouvement militant, sauf en étant sympathisant. Ils ne peuvent pas non plus dire « je voudrais d’une société sans sexisme », parce qu’ils bénéficient au quotidien des facilités liées à leur statut de garçon, et qu’on leur dit qu’en défendant cette idée ils nient la violence faite au femmes.
Boys, boys, boys a été publié en 2005. J’ai envie de croire que les choses ont évolué depuis cette période. Que les mouvements féministes ont commencé à se restructurer dans des actions et réflexions plus fines, plus efficaces, réussissant à influencer la sphère publique de manière positive.