Les maladies neurodégénératives sont nombreuses et diverses. Les plus connues sont probablement les maladies neurodégénératives liées à l’âge, comme la maladie d’Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Mais plein d’autres existent, comme par exemple la maladie de Batten, ou CLN3, une maladie génétique lysosomale dont est porteuse ma fille.
Le terme de deuil blanc est apparu il y a plus de 10 ans dans le contexte de la maladie d’Alzheimer. Il décrit le deuil que l’on ressent lorsqu’une personne atteinte d’un trouble cognitif n’a plus la même présence mentale ou affective que par le passé, bien qu’elle soit toujours présente sur le plan physique.
Dans cet article, je vous raconte pourquoi et comment j’en suis arrivé à m’intéresser à cette notion, et je vous partage la synthèse bibliographique produite par l’Équipe Relais Handicaps Rares AuRA, équipe que j’avais évoqué dans ce blog, et dont je trouve le travail formidable. Le document est consultable en fin de page.
Une maladie dégénérative
Avec l’avancée de la maladie, les symptômes deviennent de plus en plus intenses, et les personnes de l’entourage s’engagent dans un rôle de proche aidance. C’est ma trajectoire depuis de nombreuses années, et j’avais raconté une partie de ce chemin dans un podcast, quand même pas Papa !. J’aimerais trouver l’énergie et le temps de poursuivre ce podcast, car les choses ont bien évolué depuis les derniers épisodes.
Depuis le dernier épisode de ce podcast, et au fil des années, ma fille a pu bénéficier de nombreux accompagnements pour compenser son handicap croissant : fauteuil roulant adapté avec maintien, lit médicalisé, sonde entérale pour poursuivre l’hydratation et l’alimentation, utilisation de protections contre l’incontinence, d’une chaise de douche, ou encore d’aides humaines financées par la MDPH.
Avec l’avancée des symptômes physiques, les défis cognitifs et de communication se sont intensifiés. Nous abordions à ses côtés l’année 2025 en redoublant d’astuces pour réussir à communiquer, grâce au seul mot dont elle disposait encore au quotidien : « oui ». Suivant son intensité, sa fréquence de répétition, et les expressions du visage qui l’accompagnait, on arrivait à trouver notre chemin dans tout ça, comme une équipe. Elle et nous séparés par une paroi de plus en plus opaque, celui de la maladie. Les hallucinations et épisodes de terreur ont aussi été nombreux, rendant souvent difficile pour elle l’accès à une participation active à ces échanges.
Il y a plein de manières de vivre et de penser cette maladie et l’impact sur sa vie. Je l’ai toujours vue comme un filtre qui rendait de plus en plus difficile l’accès à la personne qu’est ma fille.
Et puis nous avons la chance d’être super bien accompagnés par une équipe de soins pédiatriques palliatifs, avec qui nous travaillons de concert pour trouver à chaque défi les solutions pragmatiques et fonctionnelles qui font que le quotidien se déroule le mieux possible. Une équipe mobile de médecine physique et de réadaptation nous accompagne aussi pour adapter tous les dispositifs d’aide matérielle. C’est une adaptation de chaque instant, pour accompagner l’avancée de la maladie, ce qui n’est pas une mince affaire quand il faut jongler avec la lenteur des services administratifs du département, mais aussi parce que trouver les bons dispositifs prend du temps.
Et comme tout ces besoins sont interdépendants, on doit jouer les orchestrateurs du bon accompagnement par toutes les disciplines médicales et paramédicales qui accompagnent ma fille.
De nouveaux chamboulements
Si ma fille avait accès à un seul mot (à de rares exceptions sporadiques), elle n’était pas toujours en pleine maîtrise de sa verbalisation, et il arrivait souvent qu’elle soit prise dans une boucle de répétition où le « oui » l’envahissait toutes les une ou deux secondes, parfois pendant de nombreuses heures, l’empêchant parfois de dormir, souvent de déglutir. Parfois même, je pense que cela entravait sa capacité à participer aux échanges avec nous.
Avec la fin du printemps, ces boucles se sont rapidement arrêtées, et avec elles, l’accès facile à un « oui » porteur de sens. Les gestes du repas (ouvrir la bouche, déglutir) sont aussi devenus des gestes compliqués. Et puisque la motricité générale et la motricité fine n’étaient plus accessible de manière intentionnelle pour elle depuis de nombreux mois, nous nous sommes retrouvés avec une barrière à la communication d’une toute nouvelle ampleur.
Alors on redouble d’astuce, on tente de mettre en place des petits outils, on explore des choses. Comme on connaît la personne que l’on accompagne, on peut continuer à lui proposer ce qu’elle aime, à verbaliser pour elle les éléments qui constituent son univers…
Mais avec la fatigue qui s’installe, les cycles de sommeil très perturbés, parfois avec 20 heures de sommeil par jour entrecoupés de courts réveils, avec une motricité qui ne rend plus complètement raisonnable la toilette et les transferts sans assistance matérielle plus importante, le quotidien devient vraiment difficile. Jusqu’à présent, on s’en emparait à bras le corps, à deux, ma fille et moi. En ce début d’été, j’avais soudain l’impression de me retrouver souvent seul, ses intentions n’étant plus perceptibles qu’à de furtifs moments dans la journée.
Une nouvelle manière de penser l’accompagnement
L’été avance, nous sommes à la mi-août, et je ne sais pas si cette nouvelle manière de vivre va s’installer comme une normalité pour nous. Mais il est certain que j’avais besoin de trouver de nouvelles manières de réfléchir et d’agir.
À la mi-juillet, j’ai découvert par hasard la notion de deuil blanc en regardant une vidéo d’Athéna Sol, une vulgarisatrice linguistique qui présentait les mots entrés au dictionnaire Petit Robert en 2026 :
DEUIL BLANC : Deuil éprouvé face aux manifestations de la maladie neurodégénérative d’un proche encore vivant, par dans le cas de de la maladie d’Alzheimer.
Cette idée a directement fait écho à notre vécu. Certes, je ne me sentais pas complètement démuni face à notre quotidien, j’avais construit mes outils, identifier des manières de penser notre vécu, ses besoins et les miens. Mais cette nouvelle notion donnait à lire d’une nouvelle manière tout ce que j’avais pensé jusqu’à présent. Sans être une révolution — après tout les notions sous-jacentes au deuil blanc sont déjà présentes dans ma manière de penser et d’agir — j’ai eu l’intuition que lire sur le sujet pourrait m’aider à mieux penser la suite.
Bibliographie sur le deuil blanc
Je me suis donc rapproché du centre de documentation l’Équipe Relais Handicaps Rares AuRA pour savoir s’ils avaient des ressources sur le sujet. J’avais déjà eu l’occasion d’échanger avec eux, notamment sur la question de la nourriture mixée, et je trouve leur travail vraiment formidable.
Une documentaliste m’a tout de suite répondu, et proposé de réaliser une synthèse bibliographique sur la question, qui n’avait pas été jusqu’à présent un sujet d’intérêt pour l’équipe.
Elle m’a fait parvenir par la suite une synthèse bibliographique très riche, que j’ai envie de partager avec vous. On y retrouve quelques définitions connexes (deuil intuitif, deuil instrumental), ainsi que différentes ressources destinées aux aidants, aux professionnels, ainsi que des références de livre témoignage, de podcasts de vidéos, d’articles scientifiques, de témoignages d’aidants ou encore de mémoires de fin d’étude. Les regards sont multiples, parce qu’ils sont à la fois portés par des personnes aidantes et par des personnes professionnelles, mais aussi parce que plusieurs disciplines sont sollicitées : psychologie, sociologie, gériatrie, soins infirmiers, arts.
Voici donc le document produit par l’ERHR AuRA sur le deuil blanc en juillet 2025. Un énorme merci à eux, et bonne lecture à vous, internautes de passage sur ce blog :
Premières idées
Un des premiers points qui m’a marqué, c’est que le deuil blanc n’est pas une lecture que l’on peut appliquer uniquement au vécu du proche aidant. Elle peut aussi être vue depuis le point de vue de la personne qui perd ses capacités cognitives et physiques.
Souvent on m’a demandé si ma fille avait conscience de ce qu’elle traversait. Ces derniers mois, je l’ai vue pleurer, et n’arrivant pas à identifier de cause physique (douleur, inconfort, …), j’en étais arrivé à me dire qu’elle ressentait une grande frustration à perdre les outils de communication ténus qui lui restait. Sans être certain de cela, je peux tout de même puiser dans la littérature sur le deuil blanc des pistes pour continuer à l’accompagner.
Je trouve aussi dans la lecture de la note bibliographique de l’ERHR AuRA des idées qui font bien écho à mon quotidien personnel : sentiment de solitude, besoin de consolider des souvenirs communs, importance d’exprimer son chagrin, de trouver des ressources dans l’art par exemple pour continuer à avancer. Je commence tout juste à parcourir ces ressources, qui j’en suis convaincu vont m’aider à avancer.
Bonne lecture à toi aussi, internaute qui te sens concerné·e par la question !
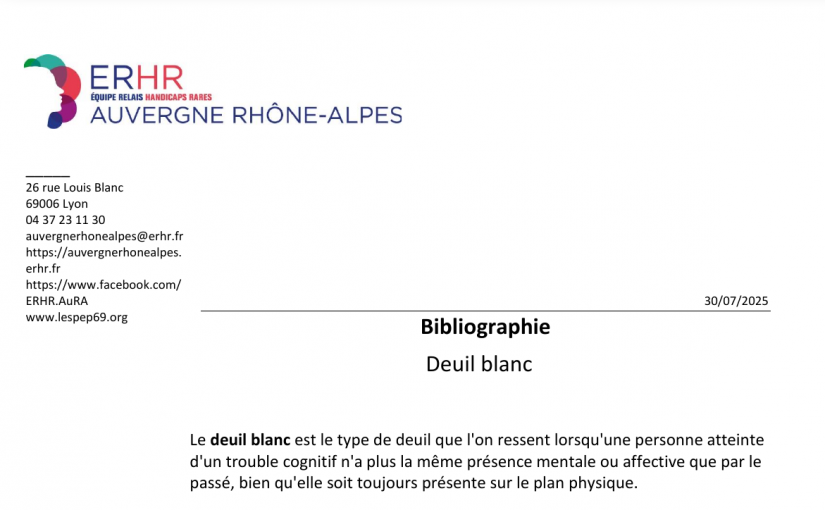
Merci JM de partager avec autant de questionnements et de détails tout ce que vous vivez !
Je crois que notre âme est la seule à vraiment exister, et je sais combien tu donnes pour Maëlyn.
Bisous x 2